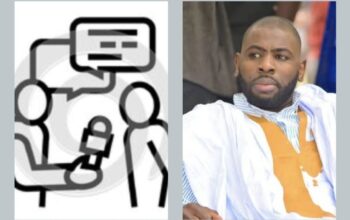Dans le vacarme du quotidien, entre les distractions du moment et l’indifférence institutionnalisée, il est encore possible ( je dis bien dans une capacité et non totale pour certains entre une mi-temps et la reprise du jeu !) de s’autoriser à penser la Mauritanie. Penser lucidement, sincèrement, au-delà des discours convenus et des appartenances figées. Repenser la Mauritanie non pas en surface, mais dans ses tréfonds mentaux, sociaux et culturels. C’est de cela dont il est question ici.
Nous sommes de facto pour construire la Mauritanie. Que faut-il ? Beaucoup diront : « Il faut des femmes et des hommes présents, engagés, déjà à l’œuvre ou prêts à servir ». Nous oublions de rajouter des individus patriotes ancrés dans l’administration, cette machine souvent critiquée mais pourtant essentielle à toute transformation durable. Il ne s’agit pas de tout réinventer, mais de mobiliser ce qui existe. Ces quelques compétences, quelques bases de données, quelques têtes bien faites aideront pour freiner le mal-développement et initier un véritable projet de société. Il faut qu’un vent de fraîcheur puisse arriver en même temps : je veux dire par-là une nouvelle élite politique qui puisse être le moteur du changement.
Mais ces personnes doivent d’abord se libérer : des préjugés, des identités enfermantes, d’un natalisme réflexe. On ne construit pas une nation sur le repli ou la méfiance. Vivre avec les autres exige une certaine décence : celle de ne pas se retrancher derrière ses blessures, qu’elles soient personnelles ou historiques. Le refus de la rencontre, de la cohabitation sincère, relève moins d’un choix que d’un symptôme — celui d’une atteinte psychologique collective.
La réflexion doit se faire sans faux-semblants. Il faut appeler à la lucidité, à la sortie du corset identitaire comme l’a suggéré un chargé de cours à la faculté de lettres, à la responsabilisation des acteurs publics. Et cette responsabilisation commence par un mot trop rare en politique : la sincérité. Difficile aujourd’hui de rencontrer des dirigeants désintéressés, honnêtes, cohérents. Peut-être cela a-t-il toujours été le cas — excusez cette digression en forme de constat.
Le véritable socle du changement, c’est l’éducation. Le professeur Cheikh Saadbouh Kamara le disait : « L’éducation est le fondement de toutes choses. » Sans elle, rien n’est possible. Avec elle, tout devient imaginable. Et c’est par l’éducation qu’on pourra remettre l’administration debout, la rendre efficace, orientée vers le service public, et non vers les privilèges de quelques-uns.
Mais il ne suffit pas de former, encore faut-il désaliéner. Il nous faut une guérison mentale. Se libérer encore et encore des blessures collectives, des récits figés, des réflexes de clan. Le développement n’est pas d’abord économique ou technique. Il est culturel. Il est psychologique. Il est politique — au sens noble du terme. Puis suivra le moment où l’on dira à l’image du professeur Mamoussé Diagne : « Le développement n’est pas descriptif mais normatif ».
Nous devons aussi remettre à leur juste place les savoirs techniques, les formations pratiques, les métiers de l’ingénierie, de la construction, de la gestion. Il est temps de valoriser les artisans du quotidien, ceux qui bâtissent avec leurs mains, pas seulement ceux qui parlent. Ces petits prétentieux ont longtemps pris la place publique en otage. La citoyenneté ne se proclame pas : elle s’apprend, elle s’exerce, elle se paie.
La religion ne peut être un socle de développement. Quelle religion, d’ailleurs ? Il n’en existe aucune qui ait bâti une nation sans stratégie, sans pensée, sans engagement réel. L’exemple souvent cité de l’Arabie saoudite le montre bien : face à l’annexion, ils n’ont pas prié, ils ont fait appel à une force extérieure pour libérer leur territoire. C’est une question de pragmatisme, pas de spiritualité.
Et pourtant, malgré l’abondance de talents, de Mauritaniens brillants qui réussissent ailleurs, aucun ne semble pouvoir sortir ce pays de l’impasse. Pourquoi ? Parce que les élites sont trop souvent hors sol, déconnectées des réalités, des urgences, des douleurs du peuple.
Il nous faut une réforme en profondeur — non pas seulement institutionnelle, mais mentale. Bus repetita ! Il faut s’attaquer à ces fractures silencieuses, celles qu’on préfère ne pas nommer. Une nation, avant de se bâtir sur les plans et les infrastructures, se construit dans la tête de ses habitants. C’est là le premier chantier. Le plus exigeant. Le plus vital.
Et si l’heure de souffler devenait aussi celle de reconstruire ?
𝐒𝐨𝐮𝐥𝐞𝐲𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐒𝐢𝐝𝐢𝐛é